Les théories économiques face aux réalités des crises environnementales
PDF
Dans l’ère de l’Anthropocène [1], il n’est plus possible de laisser hors du champ de l’analyse économique la question des relations entre l’activité économique et l’environnement, tant en termes d’exploitation des ressources naturelles que de dégradations des milieux naturels. Quels sont les instruments proposés par la théorie économique pour les gérer ? Depuis les années 1960, les questions environnementales n’ont cessé de gagner du terrain dans le champ des préoccupations sociétales. Autant que les dégradations au jour le jour de la biodiversité, de la qualité de l’air, de la concentration des gaz à effet de serre ou de la disponibilité en eaux potables, une série de catastrophes majeures ont alarmé les opinions publiques et les gouvernements. Les réactions à ces impacts sur l’environnement se sont traduites par des politiques publiques cherchant à rendre compatible la poursuite de l’amélioration du bien-être matériel avec la préservation d’une certaine qualité de l’environnement. Souvent désarmés face à la croissance démographique, les gouvernements n’ont pu que concentrer leur action sur les conséquences de l’activité économique. Le recours initial à des réglementations s’étant fréquemment soldé soit par un non-respect des normes imposées, soit par un coût jugé excessif des contrôles, nombre de gouvernements se sont tournés, à partir des années soixante-dix, vers d’autres instruments préconisés par la théorie économique. Avec plusieurs décennies de recul, peut-on considérer que ces instruments ont tenu toutes leurs promesses ?
Avec la Deuxième Révolution industrielle de la fin du 19e siècle, la mondialisation des économies, les croissances démographiques et économiques sans précédent du 20e siècle, il devient difficile de laisser hors du champ de l’analyse économique la question des relations économie-environnement. Celles-ci sont en effet de plus en plus intenses, tant en termes d’exploitation des ressources naturelles que de dégradation des milieux naturels, au point que certains considèrent que la poursuite de la croissance met aujourd’hui la planète en danger. La théorie économique propose-t-elle les instruments adaptés pour juguler les crises environnementales en cours et à venir ?
- 1. Le prix des ressources naturelles
- 2. Le coût des rejets et des pollutions
- 3. La taxe pigouvienne
- 4. Les marchés de droits à polluer ou de quotas d’émission
- 5. A l’épreuve de la réalité : dégradations progressives et catastrophes environnementales
- 6. L’exploitation des ressources naturelles
- 7. Taxations des rejets et marchés de droits d’accès à l’environnement
- 8. Messages à retenir
1. Le prix des ressources naturelles

Les ressources sont données par la nature mais, en fonction des juridictions en vigueur, elles sont appropriables. Et en réponse aux « conservationnistes » étasuniens selon lesquels le système de prix ne permet pas une gestion rationnelle des ressources naturelles, Hotelling permet de définir, pour le propriétaire d’un stock de biens qui diminue au fur et à mesure de son exploitation, une règle de maximisation de la valeur actualisée de ses bénéfices sur un horizon temporel fini [5]. Cette règle peut être formulée comme suit (Figure 2) :
- le propriétaire d’un gisement dispose à tout instant de deux options : soit extraire aujourd’hui une unité de plus, la vendre et placer son gain, soit laisser son gisement en friche, attendre un certain temps, et vendre plus tard l’unité extraite sur le marché ;
- la fixation du taux optimal d’exploitation de la ressource est donné par l’égalisation du prix du marché et du coût marginal de production auquel s’ajoute une rente de rareté exprimant la finitude du stock, donc l’indisponibilité de la ressource dans le futur ; sur cette base, l’exploitant a intérêt à extraire tant que son coût marginal n’est pas supérieur à sa recette marginale (quantité x prix de vente) ;
- le prix de la ressource naturelle, donc la rente qui lui est attachée, doit croître à un taux égal au taux d’intérêt (ou encore au taux d’actualisation), ce qui rend la conservation de la ressource in situ équivalente à son extraction et au placement du produit de sa vente rémunéré par un intérêt.
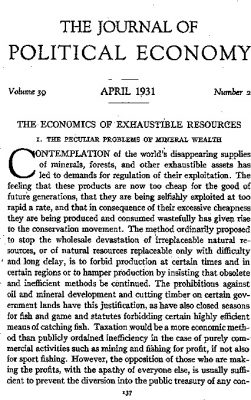
Selon cette règle, le volume total d’une ressource, donné par la nature, constitue pour le propriétaire une rente qui justifie une hausse du prix au-delà des coûts marginaux. Cette rente de rareté, différente de la rente différentielle de David Ricardo, distingue donc la ressource naturelle exploitée, renouvelable ou pas, des autres biens ou services, mais, ce faisant, elle est assimilée à du capital et suppose son appropriation. En son absence (pêche en haute mer, par exemple), les entreprises n’étant pas intéressées par la gestion optimale d’une ressource libre, c’est-à-dire non appropriable, chercheront à l’exploiter au plus vite, et donc peut-être à l’épuiser. La réponse en termes de privatisation des ressources naturelles appropriables, avancée par certains économistes n’est pas toujours applicable, notamment lorsqu’il s’agit de global commons tels que la biodiversité [6].
Au-delà de la logique microéconomique du producteur analysée par Hotelling, la question de l’exploitation des ressources naturelles sera transposée à l’échelle globale, ou macroéconomique, après la publication du rapport Meadows sur « Les limites de la croissance », en 1972 (Figure 3). Pour les économistes qui ont pris part au débat, les ressources naturelles, renouvelables ou pas, peuvent être traitées comme n’importe quel autre bien. A ce titre, elles sont réintroduites dans les modèles de croissance dans une fonction de production de type Cobb-Douglas : dans ces fonctions de production dites KLEM, les ressources naturelles, énergie (E) et matières premières (M), sont reliées aux autres facteurs de production, le capital technique (K) et le travail (L) par une élasticité de substitution signifiant qu’en cas d’augmentation de prix, E et M peuvent être remplacées par K et L.
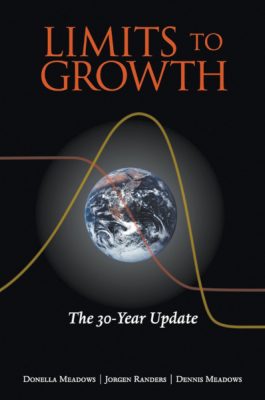
Dès lors, l’épuisement d’une ressource naturelle n’est plus à craindre puisque l’augmentation de son prix réduit sa demande tout en rentabilisant de nouveaux gisements devenus accessibles grâce au progrès des techniques [7]. Ainsi Jeffrey Krautkraemer peut-il énoncer le paradoxe selon lequel les ressources naturelles non renouvelables, appropriables et bénéficiant ainsi des ajustements par les prix, seraient moins menacées d’épuisement que les ressources naturelles renouvelables, non appropriables [8].
Mais d’autres controverses se sont nouées autour de cette problématique, notamment entre les économistes néoclassiques « standards » et les tenants de l’« économie écologique ». Pour les premiers, si l’investissement est suffisant, la destruction du capital naturel peut être compensée, du point de vue du bien-être social, par l’accumulation du capital artificiel : on parle alors de « soutenabilité faible ». Pour les seconds, le capital naturel ne peut être impunément détruit et il faut trouver un modèle de développement préservant les stocks critiques de capital naturel : il s’agit alors du concept de « soutenabilité forte ». Les recommandations politiques tirées de ces deux visions, sont évidemment très différentes puisqu’elles aboutissent soit à un optimisme technologique soit au contraire à un conservationnisme strict [9].
2. Le coût des rejets et des pollutions
Parallèlement à l’exploitation accrue des ressources naturelles, l’activité économique du monde industriel a déversé et déverse dans les milieux naturels des volumes croissants de rejets solides, liquides ou gazeux. Les agents économiques qui en sont responsables (les pollueurs) affectent ainsi la valeur de biens ou de services soit collectifs (l’air respiré par tous), soit appropriables (l’eau entrant dans la fabrication d’un produit). Non réglementées par les pouvoirs publics, de telles pratiques faussent les conditions de l’échange tant qu’elles n’entrent pas dans la formation des prix. La théorie des effets externes se propose de remédier à cette déficience selon des principes et à des conditions bien définies [10].
Une externalité correspond à l’effet qu’un agent économique procure sur les activités d’autres agents sans contrepartie monétaire, l’effet pouvant se traduire par un avantage (externalité positive), ou un dommage et une nuisance (externalité négative). De tels effets, en faussant les coûts sur la base desquels chaque agent prend une décision, sont source d’une allocation sociale défectueuse des activités, donc d’inefficacité économique. Le calcul de la rentabilité d’une exploitation forestière qui néglige les fonctions régulatrices de la forêt sur le climat ou le régime hydrique surestime la rentabilité et surexploite la forêt. De même, l’usage des véhicules automobiles en milieu urbain, qui a jusqu’aujourd’hui ignoré les conséquences pour la santé de la pollution atmosphérique a conduit à une sur-utilisation de ce moyen de transport.
Selon la théorie économique telle qu’elle sera développée dès 1920 par Arthur C. Pigou [11], de tels dysfonctionnements peuvent être évités en internalisant les externalités c.à.d. en faisant payer au pollueur la pollution qu’il a occasionnée (principe du pollueur-payeur). Une telle opération est censée traduire la valeur attribuée à l’environnement, ou le coût occasionné pour la société, et constituer un « signal-prix » envoyé aux agents économiques. La prescription théorique est cependant plus simple que son application.
Mais identifier et quantifier monétairement un effet externe est d’autant plus difficile qu’il est diffus, et qu’il affecte inégalement de nombreux agents, au cours d’un temps plus ou moins long et moyennant des perturbations souvent complexes des milieux naturels (effets de synergie, de seuil, d’amplification, d’irréversibilité). La disparition d’une forêt, par exemple, n’est pas à l’origine d’externalités identiques pour les exploitants forestiers, les chasseurs ou les promeneurs du dimanche, surtout si l’on prend en compte les valeurs d’option c.à.d. celles que les agents économiques attachent à un usage dans le futur [12]. Compte tenu de l’absence de marchés pour les services que représentent un air pur ou une eau non polluée, des techniques d’évaluation doivent être mises en œuvre de façon directe (consentement à payer révélé par la surcote d’une habitation dans un quartier peu pollué, par une enquête ou “évaluation contingente”) ou de façon indirecte (estimation de la valeur des vies perdues du fait de certaines pollutions).
En supposant surmontées les difficultés d’évaluation, il reste à définir des méthodes d’internalisation des effets externes dans les prix des biens et des services. L’analyse économique en propose deux.
3. La taxe pigouvienne

Pour Pigou, l’existence des effets externes dissocie les coûts privés du coût social (social cost) des activités économiques, ce qui est contraire à la poursuite d’un bien-être collectif ainsi qu’à l’équité (Figure 4). L’écart peut alors être réduit en imposant au « pollueur une taxe égale au dommage social marginal causé par son activité polluante » [13]. En affectant coûts et profit du pollueur, la taxe rétablit les conditions de la prise en compte des coûts sociaux et permet d’atteindre une situation de bien-être collectif optimal. Défini sur la base d’un calcul coûts-avantages, le niveau de pollution retenu par la taxe pigouvienne pose cependant un problème intrinsèque de mesure des coûts externes « à l’optimum ». Dans la pratique il lui est souvent préféré un niveau fixé par une norme gouvernementale s’appuyant sur des diagnostics d’experts, dans une logique de calcul coût-efficacité.
4. Les marchés de droits à polluer ou de quotas d’émission
La seconde approche est due à Ronald Coase [14], aborde aussi la question dans un autre article fondateur “The problem of social cost” [15]. Mais il le fait au nom d’une critique libérale de l’interventionnisme public et propose de laisser s’opérer une négociation directe entre pollueurs et victimes jusqu’à ce que survienne une entente spontanée sur le niveau de la pollution acceptable. Dans ce cas de figure, le rôle de l’État est de spécifier correctement, au pollué et au pollueur, les droits d’accès ou de propriété sur l’environnement. Aux agents économiques de négocier ensuite, jusqu’à ce que les coûts marginaux de réduction de la pollution supportée par les uns soient couverts par le consentement marginal à payer des autres.
Cependant Coase est un trop fin observateur de la réalité économique pour ignorer que les “coûts de transaction” (concept qu’il a lui-même inventé [16]) limiteront dans bien des cas les possibilités effectives de négociation. John Dales apportera une solution pratique aux difficultés de l’approche coasienne en proposant en 1968 la création de marchés de droits pour l’environnement [17]. C’est alors sur ces marchés de « permis » ou de « droits à polluer » que pourront être plus facilement conduites les négociations entre les différents acteurs.
Alors que l’approche pigouvienne se heurte à la difficulté de l’évaluation du coût de la pollution, cette seconde approche rencontre, elle, la difficulté de l’évaluation du niveau de pollution acceptable. Car les marchés de quotas ne peuvent fonctionner que si l’État ou une autre autorité publique impose une contrainte sur les droits d’accès ou d’usage de l’environnement et sur les modalités de leur répartition entre les différents acteurs.
Sous l’hypothèse de l’absence d’incertitude, les deux méthodes, de régulation environnementale par les prix ou par les quantités, sont équivalentes. Mais les choses sont bien différentes dans la réalité puisqu’en matière d’environnement, l’incertitude est omniprésente. En tenant compte des pentes relatives de la courbe des coûts des dommages et de celle de la réduction de la pollution, Martin Weitzman fournit une démonstration remarquée, parce qu’elle permet en théorie de trancher : en présence d’incertitude, lorsque la pente des coûts de réduction est supérieure à celle des coûts des dommages il convient d’intervenir par les prix (la taxe) plutôt que par les quantités (les permis), et inversement lorsque la pente des coûts des dommages est plus forte [18].
5. A l’épreuve de la réalité : dégradations progressives et catastrophes environnementales
Si depuis les années 1960, les questions environnementales n’ont cessé de gagner du terrain dans le champ des préoccupations sociétales c’est qu’elles reflètent à la fois une montée progressive des dégradations environnementales mais aussi une série de catastrophes. Une série d’évènements ont alarmé les opinions publiques et les gouvernements : les maladies et malformations attribuées au déversement de mercure dans la baie de Minamata (Japon) jusqu’en 1977 (Lire Le mercure, le poisson et les chercheurs d’or ; La Convention de Minamata sur le mercure) ; les marées noires liées à l’échouage des pétroliers Torrey Canyon en mars 1967, Amoco Cadiz en mars 1978, Exxon Valdez en mars 1989 ; les explosions des usines chimiques de Seveso (Italie) en juillet 1976 ou de Bhopal (Inde) en décembre 1984 ; les chocs pétroliers de 1973 et 1979 interprétés comme un début de pénurie d’hydrocarbures résultant d’une exploitation excessive des ressources du sous-sol ; les risques d’irradiation à grande échelle associés aux accidents nucléaires de Three Mile Island (États-Unis) en mars 1979 et surtout de Tchernobyl (Ukraine) en avril 1986, deux évènements qui ont précédé la catastrophe de Fukushima (Japon) en mars 2011.
Les réactions à ces impacts sur l’environnement ont différé très sensiblement d’une région du monde à l’autre, mais, presque partout, elles se sont traduites par un renforcement des normes environnementales et par des politiques publiques inspirées du principe de précaution (Lire focus Le principe de précaution).
6. L’exploitation des ressources naturelles
Impossible de mettre toutes les ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables, dans un même panier, mais quelques enseignements se dégagent de l’évolution de leur exploitation et de leur prix au cours des dernières décennies. A court et moyen terme, les prix des ressources naturelles fluctuent fortement, mais en tendance longue, ils n’ont pas augmenté et ce pour plusieurs raisons.
Contrairement aux hypothèses de H. Hotelling, le stock en terre n’est pas fini tant que continuent les découvertes de nouveaux gisements ou la transformation en réserves prouvées de ressources possibles. En cause, les avancées de la science et de la technologie qui ont permis, par exemple dans le cas des hydrocarbures, d’accéder aux ressources de l’offshore profond au large des côtes brésiliennes ou aux pétroles et gaz de schiste du Texas [19].
Aux incertitudes de l’offre s’ajoutent celles de la demande puisque, par le jeu des substitutions, une ressource très prisée aujourd’hui peut ne plus l’être demain. Dans le domaine de l’énergie, par exemple, la demande de charbon, gaz ou pétrole pourrait bien être fortement réduite sous l’effet d’un appel accru aux sources d’énergie non émettrices de GES. Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer des exploitants parfaitement informés, donc capable d’arbitrer entre des extractions, immédiates ou futures. Dès lors, la rationalité commande non pas de maximiser son gain sur toute la durée de vie de la ressource exploitée, mais de raccourcir ce délai, ce qui a été le cas dans nombre d’industries minières. Comme l’indiquait Morris A. Adelman l’un des meilleurs spécialistes du pétrole au MIT, la logique des pays producteurs est le plus souvent de type « take the money and run ».
Le résultat de ces décisions est bien connu : la forte croissance des taux d’extraction, donc de l’offre, fait chuter les prix, relance la demande, retarde les changements technologiques et les restructurations industrielles. Elle accentue la détérioration de l’environnement et aggrave l’injustice intergénérationnelle, ce qu’aurait pu éviter une trajectoire régulière à la hausse des prix, soutenue par une rente de rareté. La succession des phases de prix élevés et de prix bas des ressources non renouvelables confortent les analyses de Krautkraemer : celles-ci sont en général échangées sur des marchés et, malgré l’instabilité des signaux-prix, ceux-ci permettent d’ajuster l’offre et la demande sur le long terme. Pierre-Noël Giraud ne dit pas autres chose à propos des ressources fossiles et de la problématique énergie-climat. Selon lui, avec les énergies fossiles nous n’avons pas un problème de ressource, mais un problème de poubelle (le CO2 étant le déchet issu de la combustion et l’atmosphère… la poubelle) [20].
7. Taxations des rejets et marchés de droits d’accès à l’environnement
Les externalités négatives, mises en lumière par l’analyse économique, sont prises en compte par le biais de taxes environnementales, désormais très utilisées, dans tous les pays du monde [21]. En France, par exemple, plusieurs d’entre elles ont fait leurs preuves :
- les redevances des Agences de l’eau, qui datent de la loi sur l’eau de 1964, taxent les prélèvements d’eau et les activités présentant des risques de pollution des ressources en eau : leur produit est redistribué sous forme de prêts ou de subvention aux collectivités locales, aux entreprises industrielles et aux agriculteurs en vue de travaux réduisant les pollutions ;
- la Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Énergétiques (TICPE) est la plus connue par sa forte incidence sur les prix des carburants ; elle est de très loin la plus importante puisqu’en 2015, elle a rapporté près de 50% du montant de toutes les taxations environnementales ;
- depuis 2012 la TICPE inclut une composante carbone, la Contribution Climat Énergie, qui a été renforcée par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015 et qui devrait augmenter jusqu’à 100 €/tCO2 en 2030 ;
- la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) frappe les pollutions atmosphériques, les pesticides, les déchets ou les produits difficilement assimilables par l’environnement tels que les huiles, les préparations lubrifiantes ou les lessives.
En règle générale, la plupart des taxes se sont révélées efficaces, mais leur généralisation se heurte souvent aux réticences de l’opinion publique ou des acteurs économiques. Ces réticences sont à l’origine de la difficile taxation des nitrates d’origine agricole ou des émissions de CO2. De même l’écotaxe poids-lourds, en dépit de ses aspects positifs pour le rééquilibrage des transports, n’a pu parvenir à s’imposer en France [22]. Quant à la taxe carbone, dont l’augmentation programmée a déclenché la crise sociale de l’hiver 2018, son sort est encore en suspens à la mi-2019.
Lorsque la taxation est jugée trop pénalisante pour les entreprises et trop coûteuse à mettre en place par les administrations publiques, elle peut être remplacée par l’instauration de marchés de droits à polluer. Leur expérimentation est cependant encore limitée. Les États-Unis sont partis les premiers avec le Clean Air Act Amendment (CAAA) de 1990 qui a institué un « cap and trade system » sous la forme d’un marché national sur le dioxyde de soufre (SO2). Les résultats plutôt positifs de l’expérience [23] ont incité à en faire autant sur le dioxyde de carbone (CO2) : le Chicago Climate Exchange réunit 350 entreprises en 2003 ; la Regional Greenhouse Gas Intiative regroupe 10 États du Nord-Est en 2009 ; le Midwestern Regional Greenhouse Gas Reduction Accord en 2010 et la Western Climate Initiative en 2012 étendent ce type de marché à d’autres États.
Hors des États-Unis, après le Japan Voluntary Trading Emission Scheme associant 73 entreprises en 2005, les projets qui ont vu le jour en Australie et en Nouvelle Zélande n’ont pas été suivis d’effets. Dès lors, c’est en Europe que l’expérience des marchés de droit à polluer est allée le plus loin, d’abord à l’échelle des pays scandinaves puis à celle de l’Union Européenne (UE).

Après une phase pilote (janvier 2005-décembre 2007), l’EU-ETS est entré dans une phase d’apprentissage (janvier 2008-décembre 2012) qui se poursuit par une phase III (janvier 2013-décembre 2020). Au cours de cette dernière phase et au-delà, les principaux changements concernent le remplacement des plafonds d’émission nationaux par un plafond unique européen, la réduction progressive des quotas, l’abandon de leur attribution gratuite, et surtout la constitution d’une réserve stratégique. Ces réformes ont pour but de faire remonter le cours de la tonne de CO2 vers 17 € en 2020 puis 30 en 2030, alors qu’elle évolue depuis 2012 entre 5 et 10 euros, niveau jugé très insuffisant pour orienter les investissements vers des technologies moins émissives (Figure 5). Force est aujourd’hui de constater aujourd’hui que, si la réforme du marché des quotas et la création d’une réserve stratégique ont permis de redresser les prix, la divergence des intérêts en matière énergétique au sein de l’Europe n’a pas encore permis de réellement enclencher les nécessaires changements de trajectoire dans les investissements. Et la question reste posée de l’efficacité à long terme des marchés de quotas, alors même que l’instabilité du signal-prix en constitue une caractéristique intrinsèque.
C’est aujourd’hui du côté de la Chine qu’il faut regarder pour apprécier le futur des marchés de quotas CO2. Après une première phase qui a permis de tester, au sein de sept marchés-pilote, différentes structures de marché, la Chine s’engage en effet dans la mise en place d’un marché national [26]. Celui-ci ne concernera dans un premier temps que le secteur électrique. Ses objectifs seront définis par un standard d’émission défini en grammes de CO2 par kWh, décroissant dans le temps. Comme dans d’autres domaines, la Chine veille à tirer les leçons de l’expérience. L’examen des difficultés rencontrées ailleurs et le test en interne de différentes options peuvent laisser penser que le marché chinois du CO2 présente des perspectives plus favorables que ses prédécesseurs dans les autres régions du monde [27].
8. Messages à retenir
Les économistes doivent être conscients de l’importance des contributions qu’ils peuvent apporter à la définition des politiques publiques, mais ils doivent aussi prendre en compte les limites de leur discipline :
- l’analyse « coût-avantage » se heurte à d’importantes difficultés, notamment celle du calcul de la valeur des biens environnementaux qui rend largement illusoire la vision d’un économiste maitrisant tous les paramètres de la décision ;
- la fonction de l’économiste consiste à identifier, pour une norme environnementale sociale donnée, les solutions les plus efficaces ou les moins coûteuses ;
- la recherche d’efficacité, le marché et les signaux-prix ne sont pas la solution de tous les problèmes, contrairement à ce que pensent ceux qui préconisent un prix mondial unique du CO2 pour mettre fin au réchauffement climatique. Ce ne sont que des instruments indispensables pour faire évoluer certains comportements destructeurs de l’environnement ;
- une analyse économique, réduite au fonctionnement des marchés, n’est pas à même de prendre en compte toutes les relations par lesquelles l’économie s’insère dans la biosphère, via le sociétal.
Il faut s’en tenir à trois lignes de réflexion et d’action :
- laisser hors du champ de la théorie économique les décisions relatives à des biens publics, non appropriables, ce qui est fait notamment lors de l’application du principe de précaution ;
- subordonner les autres décisions à des approches « coût-efficacité » plutôt que « coût-avantage » en considérant que des pouvoirs publics, sur la base d’expertises scientifiques sérieuses, seront mieux à même de fixer des niveaux acceptables d’atteinte à l’environnement qu’un calcul de coût marginal quasi-impossible à évaluer [28];
- développer les interactions avec les autres sciences sociales, pour mieux comprendre les comportements des citoyens-consommateurs dans la transition écologique et pour caractériser les conditions de la « faisabilité sociotechnique » des innovations favorables à l’environnement.
Notes et références
Image de couverture.
[1] Introduit par le Prix Nobel de Chimie Paul Krutzen, le concept d’Anthropocène désigne la période de l’histoire dans laquelle les activités humaines ont des impacts à la fois repérables et irréversibles sur l’état de la planète.
[2] Citée par Passet René (1979). L’Economique et le vivant. Paris : Economica, 292 p (p. 38).
[3] Notamment par Jevons Stanley W (1965). The Coal Question. New York : Augustus M. Kelley Publisher, 467 p. Dans cet ouvrage, publié en 1865, l’auteur développe la thèse selon laquelle la poursuite au même rythme de l’exploitation du charbon en Angleterre implique un creusement plus profond des mines donc une élévation des coûts qui affectera inévitablement la compétitivité de l’économie britannique face à la concurrence de l’Allemagne ou des Etats-Unis, bénéficiaires de mines moins coûteuses à exploiter.
[4] Hotelling Harold (1931). The Economics of Exhaustible Resources. Journal of Political Economy, vol. 39, pp. 137-175.
[5] Ce qui suit s’inspire très largement de Vivien Franck-Dominique. Economie, op. cit, pp. 68-69 ainsi que de Bretschger Lucas et Leinert Lisa (2010). L’évolution du prix des ressources naturelles. La Vie économique. Revue de Politique Economique, n°11, pp. 4-9.
[6] Les global commons ou biens publics globaux recouvrent les biens culturels ou naturels qui devraient échapper à toute souveraineté étatique ou entrepreneuriale parce que relevant d’un patrimoine commun de l’humanité (PCH). Il est, hélas, impossible d’en donner une liste précise parce qu’en dépit d’efforts internationaux, notamment dans le cadre de l’UNESCO, leur définition n’est toujours pas acceptée par tous les pays.
[7] Stiglitz, Joseph E. (1974). Growth with Exhaustible Natural Resources: Efficient and Optimal Growth Paths. Review of Economic Studies, Symposium on the Economics of Exhaustible Resources. Solow, Robert M. (1993). An Almost Practical Step toward Sustainability. Resources Policy 19 (3):162–72.
[8] Krautkaemer J., Economics of Natural Resource Scarcity: The State of the Debate, Resources for the Future, 2005, https://media.rff.org/documents/RFF-DP-05-14.pdf
[9] On trouve une revue très complète de ces controverses dans Pezzey John C.V. and Toman Michael (2002). The economics of sustainability. A review of journal articles. Resources for the Future, January, 25 p.
[10] Cropper Maureen L. and Oates Wallace E. Environmental Economics : a survey. Journal of Economic Literature, vol. XXX, June, pp. 675-740.
[11] Pigou A.C., The economics of Welfare, 1920, files.libertyfund.org/files/1410/Pigou_0316.pdf
[12] Henry Claude (1990). Efficacité économique et impératifs éthiques : l’environnement en copropriété. Revue Economique, 41, pp. 195-214.
[13] Vivien Franc-Dominique. Economie, op. cit, p. 58-61.
[14] Economiste anglais (1910-2013), Ronald Coase s’est fait connaître, notamment, par son article « The nature of the firm » (1937) qui peut être lu dans sa traduction française « La nature de la firme », Revue Française d’Economie, 1987, vol. II/1, pp. 133-163.
[15] https://www.law.uchicago.edu/files/file/coase-problem.pdf
[16] Il s’agit des coûts d’information, de négociation et de décision, de suivi et d’exécution impliqués par toute transaction.
[17] Dales John Harkness (1968). Pollution, property and prices. University of Toronto Press.
[18] Né en 1942, Martin Weitzman enseigne à l’Université de Harvard. On peut lire : Weitzman Martin L. (1974). Prices vs quantities. Review of Economic Studies, 4(4), pp. 477-491. Weitzman Martin L. (1978). Optimal rewards for economic regulation. American Economic Review, 68 (4), pp. 683-692. Criqui Patrick (2009). Au coeur du futur régime climatique international : taxes ou quotas CO2 ? In Tirole J. (ed.). Politique climatique : une nouvelle architecture internationale. Paris : La Documentation française. pp. 261-270.
[19] Phénomènes non pris en compte par les tenants de la thèse du peak oil que nous avions critiquée dès l’origine. Martin Jean-Marie (1999). Concerning « The end of cheap oil ». Energy Policy, vol. 27, 2, February, pp. 69-72.
[20] In L’homme inutile : du bon usage de l’économie. Odile Jacob, 2015.
[21] Rotillon Gilles(2007). La fiscalité environnementale, outil de protection de l’environnement. Regards croisés sur l’économie, n°1, pp. 108-113.
[22] Son lancement a été stoppé en octobre 2013 par la violente opposition des « Bonnets rouges » bretons à une taxation des poids lourds assimilée à une écotaxe.
[23] Une analyse très fine de ce marché est proposée par : Schmalensee Richard and Stavins Robert N. (2012). The SO2 Allowance Trading System: The Ironic History of a Grand Policy Experiment. The Journal of Economic Perspectives, August 3, pp. 1-23..
[24] Dans la très abondante littérature sur le sujet, une étude des fondements de l’UE ETS peut être consultée avec profit : Ellerman A. Denny, Joskow Paul L. (2008). The European Union’s Emission Trading System in perspective. Pew Center on Global Climate Change, Massachussets Institute of Technology, 50 p.
[25] Les quotas sont attribués annuellement par chaque pays membre de l’Union Européenne sur la base des émissions passées ajustées d’un facteur de réduction.
[26] Guoyi Han and others. China’s carbon emission trading. Stockholm : Fores, 56 p, et plus récemment, Chine : le marché du carbone, Enerpresse n°11 976, 22 décembre 2017.
[27] Lancé fin 2017, ce marché, pour l’instant limité au secteur électrique, ne deviendra réellement opérationnel qu’en 2020.
[28] Pour plus de détails, voir Patrick Criqui, Benoit Lefèvre (2010), in B. Zuindeau, ed. : Développement Durable et Territoires, p. 193.
L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.
Pour citer cet article : MARTIN-AMOUROUX Jean-Marie, CRIQUI Patrick (9 septembre 2019), Les théories économiques face aux réalités des crises environnementales, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 3 décembre 2024 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/societe/theories-economiques-crises-environnementales/.
Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.







